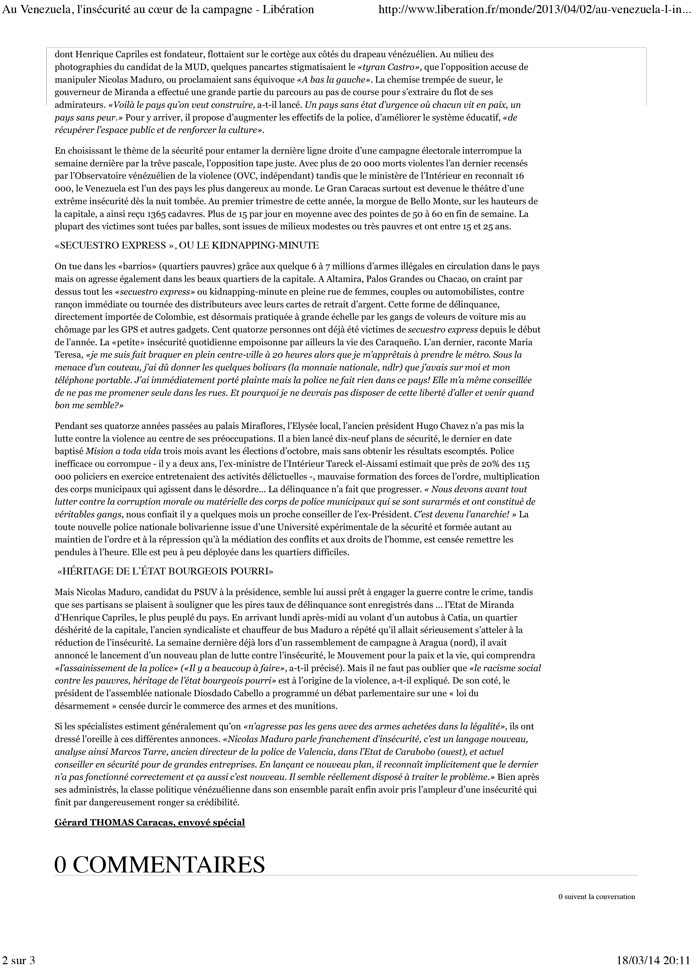Le Venezuela est aujourd'hui considéré comme l'un des cinq pays les plus dangereux au monde, avec un nombre de morts violentes croissant - estimées à près de 25 000 en 2013 pour l'ensemble du pays - 1.
A cette réalité s'ajoute une insécurité qui, à Caracas, se rend quotidiennement présente au travers d'expériences rapportées de proches, de la mauvaise réputation attribuée à certains lieux ou encore par le biais les médias. Au-delà des expériences directes d'insécurité, cet enchevêtrement de statistiques, de faits, d'anecdotes, de représentations et de rumeurs fonctionne comme une accumulation d'indices symboliques et sensibles qui se diffusent de la sphère privée à la sphère publique et par lesquels l'insécurité s'institue de manière confuse mais durable chez tous les acteurs, finissant par former nous avons qualifié de "magma insécuritaire" 2.
Dans ce contexte sur-connoté où l'insécurité se trouve à la fois surinvestie et banalisée, l'attitude courante des institutions et des citadins oscille entre vigilance exacerbée et nonchalance. Si la montée en puissance de la première induit la « sociabilité de surveillance » qui distingue notre ère sécuritaire, la deuxième apparaît comme l'acte-réflexe d'une société fatiguée d'être aux aguets. Ceci arrive lorsque l'incertain, perdant son espace propre, est traduit en danger.
Instaurés en principes, le risque, la probabilité de l'agression voire le soupçon font alors de la vigilance une compétence mobilisée par chacun dans les situations les plus ordinaires, en voiture, dans la rue, les transports... La vigilance et ses excès à Caracas peut être considérée comme l'une de déclinaisons contemporaines de la vulnérabilité 3.
Un premier extrait d'entretien, réalisée avec une collègue universitaire, habitante du centre-ville de Caracas, évoque les critères à la fois réputationnels et sensibles qui l'amènent à éviter de prendre le minibus dans certaines situations.
Le second extrait est issu d'un entretien informel réalisé avec un chauffeur de taxi. Lucio n'a pas quarante ans et a commencé à travailler comme chauffeur de taxi en 2000. Diplôme d'informatique, après avoir vécu quelques années à l'étranger et travaillé pour le gouvernement, il fait le taxi à Caracas avec son chevrolet d'occasion. Il dit lui-même préférer ce métier car il est « son propre chef » et surtout pour les recettes que cela lui procure : jusqu'à 10 000 Bsf lors d'« une bonne journée » et 4000 BsF lors d'une « mauvaise » 4. Pendant ces douze années, il a eu le temps de (presque) tout voir, tout éprouver : depuis les arnaques de passagers jusqu'au kidnapping, en passant par plusieurs vols à main armée et une agression où il a failli mourir. Malgré sa plainte de voir que « l'insécurité est à l'origine d'une diminution sans précédents du volume de travail », il continue à faire le taxi : « Combien de personnes peuvent dire qu'ils peuvent gagner jusqu'à 15 ou 20 mille BsF par mois, tout en étant sa propre ressource humaine, en faisant les « publics relations » et en ayant l'emploi de temps de son choix ? ». Lucio est donc loin d'être dupe ou de méconnaitre les menaces qui cernent le métier de taxi, notamment dans un contexte où les malfaiteurs ont appris à privilégier les situations de mobilité urbaine pour commettre leurs délits et leurs crimes et où l'impunité règne. Pourtant, il préfère continuer à exercer ce métier à haut risque. Lucio est, comme d'autres caraquéniens, un être de contradictions qui cependant les assume (ou fait semblant) ne cessant d'affirmer en même temps « l'importance de la confiance pour travailler ». Voire « l'amour de son métier » parce qu'il remplit ainsi le quota qui lui correspond de collaborations pour « habiter dans une meilleure ville ».
Enfin, nous reproduisons un reportage publié dans le quotidien Libération le 02 avril 2013, consacré à la place de l'insécurité dans la campagne présidentielle vénézuélienne de 2013.
1 Estimation établie par El Observatorio Venezolano de Violencia, organisme indépendant. En 2003, année à partir de laquelle les statistiques de la criminalité recensées par les autorités vénézuéliennes n'ont plus été librement accessibles, les homicides avaient été de moins de 12000. Cf. http://observatoriodeviolencia.org.ve/ws/informe-del-ovv-diciembre-2013-2/
2 Garcia Sanchez P., « Ressources et dilemmes de la vigilance. Des épreuves du trouble ordinaire à la sociabilité de surveillance », in Etre vigilant : l'opérativité discrète de la société du risque (J. Roux ed.), 2006, Université de Saint Etienne, Saint-Etienne, p. 237-254.
3 Garcia Sanchez P.,« De ville en cité. La (re)connaissance de la vulnérabilité », in La reconnaissance à l'épreuve. Explorations socio-anthropologiques, Lille, Presses universitaires Septentrion, 2008, p. 277-284.
4 Le « salaire minimal » au Venezuela (équivalent lointain du RMI en France) était de 1547 bsf en 2011.
Extrait d'entretien avec une collègue universitaire, habitante du centre-ville de Caracas, en août 2011
"En général je ne prends pas le minibus, ou pas beaucoup, parce que c'est dangereux de le prendre à l'avenue Libertador... l'accès. Et aussi - c'était pas mon cas heureusement, mais des fois il y en a plusieurs qui se sont fait voler, des "robos collectivos" (vols collectifs), sur le trajet de l'avenue Libertador.
Pour descendre à l'avenue Libertador, il y a un escalier, c'est parfait pour les voleurs. C'est une avenue à deux niveaux, le minibus prend la route en bas, et c'est une voie rapide ; il n'y a pas beaucoup de monde. Et il n'y a pas de surveillance, pas du tout de policier, de garde national... Tous les jours c'est comme ça, donc les voleurs ont trouvé je crois, que c'était facile de voler là.
La situation dont je suis en train de parler, les vols collectifs dans les bus, c'est plutôt en fin de journée. Les minibus ferment les portes et ne s'arrêtent que si c'est vraiment nécessaire, aux arrêts prévus, ils passent vite, vite, très vite, parce qu'en fait c'est un endroit pour se faire voler dans les minibus. Mais aussi en attendant dans l'escalier. Et l'escalier, c'est sale, très très désagréable."

© Rem Sapozhnikov - http://www.tiwy.com/pais/venezuela/fotos_de_caracas/dorogi/eng.phtml
Cette photo de l'avenue Libertador montre, dans sa partie semi-enterrée, montre les arrêts de bus et les escaliers évoqués dans l'entretien
Extrait d'entretien informel réalisé avec un chauffeur de taxi à Caracas, en août 2011
Taxista (T): Yo empecé esto en el año 2.000 y había trabajo para tirar hasta el techo, pero ¿Qué ha hecho la inseguridad? Que la gente no salga. La inseguridad ha hecho que ya el trabajo no sea... Yo trabajo hasta las doce de la noche, hasta ahí hay vida, de resto, solo uno que otro que tiene que ir a un sitio específico, donde están las rumbas: el San Ignacio (centro comercial), las Mercedes, porque más nada.
Investigador (I): ¿Y eso es después de las doce? Y antes, si puedes andar ruleteando por cualquier lado?
T: Consigues trabajo, pero después de las doce, muy difícil, ya Caracas no es lo que era, la gente rumbeaba hasta los lunes. Ahora la gente se va pa' la casa de un pana, y se toma los tragos ahí. Pero eso de discoteca? Ahora las discotecas son contadas, aparte del costo para entrar, ahorita te cobran por ver, por entrar, una botella de whisky te vale mil bolos, la entrada 50 bolos...
I: Y eso, tú dices que cambió, que en el 2.000 era de otro modo y a partir de aquel momento empezó a cambiar? ¿En qué momento tú crees que eso empezó a cambiar?
T: No, eso se ha ido degenerando... Poco a poco. Y de hecho sólo ves, que los centros comerciales, es muy poco lo que tienen de rumba; el único es el San Ignacio, que tiene todos los lugares de rumba que cierran a las 4, pero antes era muy diferente...
I: ¿Es el único?
T: Es el único que puedes ir con seguridad de que vas a rumbear y no estás preocupado por los malandros. El único sitio. Porque tú estás en Las Mercedes y entonces andas “chorreao” porque te pueden secuestrar, porque te puede pasar algo.
B: ¿Y qué es lo que hace que no sea así en el San Ignacio? Porque estás en Chacao?
T: Bueno, porque en las cuatro esquinas ponen alcabalas y por lo menos los ves, entonces si los ves te da seguridad. Ahhh “que en el estacionamiento pasa alguna cosa o pasa otra?” En Caracas no hay ningún lugar seguro ya, pero de ahí a que te digan que te van a meter un tiro, hasta allá no llega. Y al final lo que importa es preservar la vida.
I: Y en tus once años de trabajo como taxista ¿te han pasado vainas?
T: Todas : secuestro, atraco, se han llevando el carro, me han caído a golpes... Me han salido todas las barajitas (...) Lo del secuestro es lo más grave porque es la impotencia que te da, un poco de carajitos (porque no puedes decirlo de otra manera), que cuando quieren matar a un tipo, te secuestran y bueno... Lo más grave no es el hecho como tal sino que cuando tú vas a las autoridades...
(...) O cuando me atracaron y se llevaron el carro... Eran dos chamos, y uno me pone un pico ‘e botella en la garganta y entonces me pongo a forcejear pa' que no me vaya a cortar, entonces me empiezo a caer a golpes con el tipo y entonces el de atrás me pega, siento que me está cortando, entonces me pongo a forcejear y me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí vale? Total el carro tiene satelital.
I: ¿El carro tenía satelital?
T: Sí, el que está delante se viene pa' acá pa' manejar el carro...
I: Ah porque tú dejaste el... ahh ok.
T: Claro, pero con mocha, porque el hace el paro de que va a vomitar de que se siente mal, entonces, yo me paro con el croche metido y con la velocidad puesta, cuando el tipo me jala el carro se apaga, claro cuando yo me voy pa' atrás el carro se apaga, cuando me pongo a discutir con el chamo, entonces de repente... “¿Y yo qué estoy haciendo aquí buscando que me maten?” Entonces... me bajo del carro y yo estoy aquí a las doce de la noche llamando a la operadora para que me apaguen el carro...
como a las 3 horas me llaman, de hecho me llama un agente de la Policía Metropolitana y me dice:
“Policia metropolitano: Señor Rojas, buenas noches, encontramos su carro. Hicimos un buen trabajo y usted sabe que pa' entregarlo es un proceso, y si usted quiere bueno, puede pasar por aquí y podemos hablar y broma... véngase, nos da una colaboracioncita porque hicimos un buen trabajo....”
¿Sabes cuánto me estaban pidiendo? Un millón de bolívares! Pa' entregarme mi carro!
I: ¿Hizo denuncia en PTJ (policía judicial)?
T: No, no hice denuncia en PTJ
I: Porque si hubieras hecho la denuncia en PTJ te hubieran ladillado más...
T: Hubieran tenido que trasladar el carro hasta la PTJ y hubiera sido un rollo, pero como en PTJ, tienes que hacer la denuncia personalmente y con los papeles en la mano, sino no te meten en el sistema. Por ejemplo a ti te roban el carro y tú llamas a la PTJ y te dicen: No sí, tranquilo, nosotros lo radiamos. Hasta ahí... pero como tal, no hacen nada, hasta que tú vas con los papeles, mira aquí está el documento de propiedad y entonces ahí es cuando te dicen: Ah bueno entonces vamos a formalizar la denuncia. Pa' que sepas.
I: Qué arrecho!
T: Sí, entonces imagínate si hasta la policía te martilla, ¿qué queda pa' los demás?
I: ¿Y qué hiciste por fin?
T: Bueno lo que pasa es que ellos no contaban con que mi prima es Fiscal Nacional entonces llamé a mi prima y me dice: No, habla con el comisario tal. Y después los tipos se arrecharon.